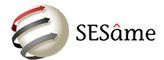Le programme
Les séquences de cours
Identification
S'abonner à la Newsletter
Entretien avec Florence Jany-Catrice et André Vanoli
- Details
- Parent Category: Entreprises et Organisations
- Category: Qui crée des richesses et comment les mesurer ?
- Last Updated on Wednesday, 01 February 2012 20:26
- Published on Tuesday, 04 October 2011 13:15
Florence Jany-Catrice, économiste à l’université Lille-I, est une spécialiste des comparaisons internationales portant sur l’emploi tertiaire, de l’emploi non qualifié dans les services, et des indicateurs sociaux. Chercheure au Clersé : Centre lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques. Co-auteurs avec Jean Gadrey de Les nouveaux indicateurs de richesse, Repères n°404, La Découverte, 2007. Page professionnelle
André Vanoli a dirigé à l'INSEE, la comptabilité nationale, la coordination statistique et les relations internationales. Il a mis en place le Conseil national de l'information statistique (CNIS). Il a participé étroitement aux travaux d'harmonisation internationale du système de comptabilité nationale, en particulier à ceux qui ont abouti au SEC 70, puis au SCN 93/SEC 95. Auteur de Une histoire de la comptabilité nationale, Grands Repères, La découverte, 2002.
SESâme : Le PIB est un des indicateurs économiques les plus commentés ; désormais l’un des plus critiqués aussi. En quoi reste-t-il utile pour l’analyse économique ?
André Vanoli : On peut transformer la question en se demandant : « Est-il utile de mesurer la production, les revenus qui en sont tirés, et les utilisations qui sont faites des biens et des services qui résultent de la production (consommer, exporter, investir,etc.) ? Est-il utile de calculer, ce faisant, un ou plusieurs agrégats macroéconomiques, c’est-à-dire des mesures globales de ces trois phénomènes (la production, le revenu, l’utilisation /la dépense), qui peuvent servir, avec d’autres statistiques d’indicateurs généraux de l’activité économique ? »
A la question ainsi formulée, peu de gens répondraient que ce n’est pas utile et on ne voit pas bien pourquoi, en première analyse, il y aurait place pour un débat passionné. Mesurer ce qui est résumé ci-dessus n’est pas seulement utile, c’est indispensable, aussi bien que mesurer l’emploi, le chômage et les prix de détail.
Des difficultés ont surgi cependant de divers côtés[1]. Comme l’objectif de maximiser la croissance économique, entendue comme l’augmentation de la production, a été critiqué pour les conséquences négatives qu’il entraînait, de la critique de l’objectif on est souvent passé à celle de l’instrument principal de mesure de la croissance lui-même. On a ainsi parlé de rejeter l’objectif de « maximiser le PIB ».
Enfin et surtout on a voulu faire dire à cet agrégat de la production plus que ce qu’il cherchait à mesurer et du coup plus que ce qu’il mesurait effectivement pouvait dire.
On a fait comme si la variation du PIB cherchait à mesurer la variation du bien-être et on a alors aisément démontré qu’il remplissait mal cette fonction (qui en effet n’était pas la sienne : « si je ne suis pas un joueur de guitare, je ne peux pas être un mauvais joueur de guitare »). Or, la production, le PIB, se situe du côté des moyens (ce n’est pas le seul), mais ne mesure pas les résultats de l’utilisation des biens et services et des autres moyens dont disposent les populations (en termes de bien-être ou plus généralement de qualité de vie).[2]
On a ainsi souvent voulu faire trop dire au PIB. Au cours du temps on a présenté beaucoup de propositions destinées à le modifier de manière à lui faire dire ce qu’il ne cherchait pas à dire. Dans les dernières années, il a été généralement reconnu qu’aucun agrégat économique en valeur monétaire, ni même probablement aucun indicateur synthétique unique, ne pourrait représenter à lui seul l’ensemble des phénomènes dont on cherche à rendre compte sous les vocables, par exemple, de bien-être ou de qualité de vie, de développement durable, etc.
Florence Jany-Catrice : C’est une question délicate mais aussi très importante car ce constat assez juste est la démonstration que l’analyse du contenu des indicateurs ne peut être découplée de celle des conditions socio-politiques et institutionnelles (c’est-à-dire qu’on se pose la question de savoir qui va élaborer les indicateurs ? qui va les valider ? etc.) dans lesquelles ils peuvent émerger en tant que convention partagée (c’est-à-dire comment trouver un accord sur ces indicateurs?).
Le PIB continue d’être largement utilisé parce qu’il a un format efficace pour une action publique et médiatique, qui privilégie la diffusion rapide des informations économiques.
Il continue d’être largement utilisé parce que la contestation autour de la croissance comme finalité des sociétés ne fait pas l’unanimité. Si cette contestation monte dans la société civile organisée, elle est faible ou inexistante chez les élites économiques et politiques qui continuent de se référer largement au PIB et à sa croissance.
Cependant, si ces agrégats économiques continuent d’être des indicateurs hégémoniques dans les finalités de l’action publique, ils ont été largement effrités en tant que vecteur central dans la formation des jugements collectifs sur la richesse et le progrès. Cela s’est fait sous la pression de certains organismes internationaux à l’instar du PNUD et de ses indicateurs de développement humain, mais aussi de la société civile organisée qui est à l’origine de nombreux autres indicateurs, comme l’empreinte écologique[3].
SESâme : Le PIB apporte-t-il une évaluation satisfaisante de la production non marchande (PNM) ?
André Vanoli : Il faut distinguer la question de la pertinence de l’évaluation de la PNM[4] telle que les comptes nationaux usuels la recouvrent et celle de l’extension éventuelle de ce champ.
Les comptes nationaux incluent ce que l’on peut appeler la PNM monétaire. Les produits, généralement des services, issus de celle-ci, ne font pas, sauf à la marge, l’objet de ventes, mais ses facteurs de production sont, pour l’essentiel, acquis sur les marchés (des biens ou du travail). Elle est le fait des administrations publiques (APU) ou d’organismes privés sans but lucratif (associations, etc.). Pour cette PNM, le jugement diffère selon que l’on considère l’estimation de la valeur courante de la production ou celle de sa variation en volume (« à prix constants » c’est-à-dire une fois enlevés les effets de l’inflation).
La valeur courante (non déflatée) de la production est généralement mesurée par ses coûts de production (éventuellement, mais le cas est assez rare, on peut retenir les prix de produits marchands équivalents). On débat sur le point de savoir si ces coûts devraient inclure une estimation pour la rémunération nette du capital investi (on parle souvent de coût d’opportunité) pour les APU[5] notamment[6], ou encore une estimation de la valeur du travail des bénévoles dans le mouvement associatif. Mais de manière générale, on ne remet pas en cause, faute d’alternative, la mesure en valeur courante par les coûts[7] (l’estimation de prix fictifs serait une opération hautement problématique, si tant est qu’elle ait un sens).
Cependant, la couverture elle-même de la PNM dans les comptes usuels a été questionnée. La critique vise surtout l’absence d’une PNM pour les services rendus à l’intérieur des ménages par les activités ménagères non salariées. Il y a maintenant un accord assez général sur le fait que ces services, dès lors qu’ils sont rendus à d’autres membres du ménage, font en principe partie du champ de la production au sens des comptes nationaux (par exemple la préparation des repas, la lessive, le nettoyage, les soins donnés aux enfants par les parents), et devraient faire l’objet d’estimations périodiques, par exemple tous les cinq ans. Comme ici il s’agit principalement de donner une valeur au temps de travail gratuit consacré aux activités ménagères, l’étendue de ces activités, et la forte divergence des résultats obtenus selon les méthodes d’estimations retenues[8], font juger préférable de ne pas essayer d’inclure cela dans les calculs réguliers du PIB. Celles-ci continuent ainsi à correspondre à l’emploi salarié et non salarié, tel qu’il est mesuré par les statistiques économiques et sociales abondamment commentées chaque mois.
Florence Jany-Catrice : Jusque 1976, le PIB ne comptabilisait pas la production non marchande fournie par les administrations publiques. Lorsque ces services ont été intégrés à l’agrégat, s’est posée la question de la valeur à affecter à des services caractérisés par leur absence de prix. En général, la comptabilité nationale repose alors sur le principe que la production de ces services non marchands produit au moins ce qu’elle coute. On attribue alors come valeur monétaire le cout de production (pour l’essentiel, les salaires). Cela pose plusieurs problèmes.
Un problème de frontière d’abord : pourquoi un certain nombre d’autres services non marchands ne sont-ils pas inclus dans ce périmètre de la production, à l’instar de l’activité bénévole des associations, ou de la production domestique ?
Un problème de mesure ensuite puisque cette manière de valoriser l’activité non marchande se limite à la valorisation des inputs[9]. Cette manière de faire n’est pas propre aux services non marchands. Elle est fréquente dans les activités de services, et est utilisée dès lors que l’on a des difficultés à identifier ce qui est produit (dans les services d’aide auprès des personnes âgées par exemple, on tend à assimiler le « produit » -ce que fait l’aidant, et l’« heure de travail »- qui est en fait l’input).
Elle conduit mécaniquement au postulat d’une stagnation de la productivité dans ces activités, puisque la productivité rapporte normalement un output (ou produit) sur un input.
Mais cette convention de mesure pose des questions plus vastes qui ont trait à ce qu’est le produit dans les services : que produit le domaine de la santé ? Celui de l’éducation ? Quels indicateurs retenir pour évaluer les résultats de cette activité ?
L’une des solutions possibles consiste sans doute à quitter les chemins de la monétarisation et à tenter d’identifier, en consultant largement l’ensemble des parties prenantes, ce qui peut être considéré comme la mission. Dans la santé par exemple, doit-on considérer que la « production » est la somme des revenus versés aux personnels de santé, ou qu’elle est l’état de santé de la population ?
SESâme : Quels seraient les changements les plus importants à mettre en œuvre pour mieux prendre en compte l’environnement (dans le calcul du PIB) ?
André Vanoli : Deux questions surtout sont posées à la comptabilité de l’environnement.
La première concerne l’extraction des ressources non renouvelables (pétrole particulièrement). Depuis toujours, les comptes nationaux incluent dans la valeur de la production des industries extractives la totalité de la valeur des quantités extraites. De la sorte, la rente (qui mesure l’excédent des profits réalisés dans les activités considérées sur les profits « normaux » ou habituels dans les activités économiques) entre dans la valeur ajoutée de l’extraction et dans le PIB (et ensuite dans le produit intérieur net). Depuis longtemps, cette pratique est très généralement jugée insatisfaisante[10]. Les avis divergent sur les solutions, avec deux orientations principales. La première considère la rente comme un supplément de consommation de capital fixe (au même titre que l’amortissement d’une machine). Ceci aurait comme effet de diminuer le produit intérieur net (PIB-CCF[11]), mais laisserait le PIB inchangé. La seconde considère la rente comme le prix de cession par le propriétaire à l’extracteur (qui peuvent évidemment coïncider) de la tranche de la ressource non renouvelable extraite au cours de la période. Cette cession d’actif n’entrerait pas dans la valeur ajoutée de l’extraction et donc cela diminuerait le PIB (c’est la position que je défends).
Les ressources renouvelables (poissons sauvages par exemple) posent un problème analogue, quoique plus complexe, pour les quantités extraites au-delà de la capacité de régénération naturelle de la ressource considérée.
La seconde question est beaucoup plus difficile à résoudre. Il s’agit de la prise en compte éventuelle dans la comptabilité nationale, non plus du prélèvement de ressources par l’extraction, mais des dommages, quantitatifs et qualitatifs, qui sont causés sans compensation aux actifs naturels de toutes sortes par l’exercice des activités économiques (du fait des pollutions, des rejets de déchets, des transformations des espaces naturels, etc). Il a été souvent proposé, dans les projets d’agrégats alternatifs, d’estimer ces dommages et de traiter leur valeur comme un supplément de CCF, analogue à la CCF des actifs économiques, c’est-à-dire comme des sortes d’amortissements[12].
J’ai développé l’idée selon laquelle la meilleure manière de prendre en compte ces dommages dans la comptabilité nationale serait, non pas de déduire leur valeur du PIB, mais de l’ajouter à la valeur de la demande finale (consommation et investissement). On viserait alors une estimation de la demande finale aux coûts totaux, les coûts totaux étant la somme des coûts économiques payés (en simplifiant : ceux qui se retrouvent dans le PIB) et des coûts écologiques non payés. Bien entendu, estimer cela n’est pas simple[13].
Florence Jany-Catrice : En amont de cette interrogation, on peut questionner la pertinence d’intégrer un compte environnemental dans le calcul du PIB, parce qu’il y a certains avantages mais aussi des inconvénients majeurs à élaborer un indicateur synthétique type « PIB vert ».
L’intérêt majeur de l’élaboration d’un tel agrégat est d’envisager de continuer à s’adosser au PIB, assez hégémonique, tout en l’adaptant aux priorités environnementales. L’idée générale est alors de retrancher du PIB certains couts environnementaux (couts de la dégradation des sols, de l’air, de l’eau, couts liés à la baisse de la biodiversité). Il y a néanmoins deux grands inconvénients à cette manière de compter. D’abord, intégrer ces coûts dans ce nouvel agrégat nécessite de convertir toutes les grandeurs en valeurs monétaires. Or, un certain nombre de « coûts » environnementaux n’ont pas d’équivalent monétaire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de prix « spontané » puisque les biens environnementaux ne transitent pas sur un marché. Il faut des hypothèses parfois héroïques pour opérer cette conversion. Cela conduit ensuite à se limiter aux services rendus par la nature, dans une vision, voire une éthique, anthropocentrée (cela signifie que, dans son rapport à la nature, l’homme se positionne au centre du système) : dans cette vision anthropocentrée qui met donc l’homme au centre et la nature à la périphérie, on n’affecte de la valeur qu’à la nature qui a une utilité pour l’homme. Mais en étendant la monétarisation du patrimoine environnemental au-delà des services qu’il rend (il existe des méthodes qui permettent par exemple d’affecter un prix à tout type de bien, y compris naturel non marchand[14]), on est alors prêt à affecter un « prix » aux paysages, aux espères rares, à la biodiversité, et à des tas de choses dont la valeur n’a pas de prix…. Et on admet alors une substitution possible entre ces « choses ».
Une autre voie, qui a sans aucun doute plus d’avenir, consiste à partir de comptes physiques, à l’instar des « empreintes » (empreinte eau, empreinte carbone, empreinte écologique), qui viennent compléter les bilans économiques et sociaux.
[1] Du fait que ces trois notions (production, revenu, dépense), quoique distinctes, sont interdépendantes, on a eu tendance à centrer l’attention sur l’agrégat de la production (le PIB), en négligeant celui du revenu (le revenu national brut ou RNB) et celui de la dépense (la dépense nationale brute ou DNB). On a ainsi parlé, surtout dans le passé, et les comptables nationaux ont une grande responsabilité en cela, de trois optiques ou de trois mesures du PIB, au lieu de trois agrégats significatifs pour eux-mêmes.
[2] En outre, on a fait comme si la variation du PIB cherchait à mesurer la variation du patrimoine en général, alors qu’il se relie seulement, si on en déduit la consommation de capital fixe (CCF), à la variation du seul patrimoine économique pour autant qu’elle soit due aux activités productives elles-mêmes. D’où, par exemple, la critique selon laquelle il était aberrant de compter positivement dans le PIB la reconstruction des immeubles détruits par un tremblement de terre, alors que la valeur des immeubles détruits elle-même n’en était pas déduite (la comptabilité nationale est un ensemble cohérent, qui est loin de se limiter au PIB ; elle déduit la valeur de ces destructions dans un de ses comptes de variation du patrimoine, et non pas dans son compte de production). Une autre critique, plus sérieuse, vise le fait que le PIB ne prend pas en compte négativement les atteintes aux actifs naturels dues à l’exercice de activités économiques (voir sur ce point la réponse à la question 3).
[3] L’empreinte écologique a pour objectif de mesurer la surface écologiquement productive de terre (ou de mer) nécessaire à la consommation d’un individu ou d’une société : il faut une certaine surface de terres agricoles pour produire un vêtement ; il faut une certaine surface de terres pour séquestrer les gaz à effets de serre liés à nos modes de consommation etc. On peut aller voir les travaux d’Aurélien Boutaud et de Natacha Gontran.
[4] PNM : Production non marchande
[5] APU : Administrations publiques
[6] Pour illustrer ce point : les APU investissent des biens d’équipement (« immobilisent » du capital) dans les routes et d’autres infrastructures publiques de transport. Dans les coûts par lesquels on mesure la PNM, on prend en compte par exemple les dépenses d’entretien courant (personnel et matériaux)) et aussi l’amortissement des biens d’équipement (une quote-part de leur valeur pendant chaque période pour leur usure). Mais les fonds immobilisés dans la construction des routes ne sont plus disponibles pour d’autres usages. En particulier on pourrait imaginer de plutôt les prêter à d’autres utilisateurs, en échange de quoi on recevrait un intérêt payé par ces derniers. La question, jusqu’alors résolue - à tort il me semble - par la négative est de savoir s’il faudrait « imputer », c’est-à-dire attribuer aux fonds immobilisés par les APU dans leurs équipements, un intérêt (capital immobilisé multiplié par un taux d’intérêt « normal ») qui entrerait dans les coûts de la PNM.
[7] En revanche, après une longue période au cours de laquelle on estimait la variation de la PNM en volume par celle des coûts en volume (à prix constants) -éliminant ainsi toute estimation de la productivité des APU-, l’accent est de plus en plus mis depuis quelques décennies sur une estimation directe de la variation de la PNM en volume au moyen d’indicateurs statistiques portant directement sur le volume des services rendus aux utilisateurs. Des travaux en ce sens sont en cours, notamment sur les services éducatifs. Mais l’estimation en volume de la variation de la PNM des APU reste encore très imparfaite.
[8] Les études ont été nombreuses, en particulier pour les pays de l’OCDE, dans le dernier tiers du 20ème siècle. Elles montrent que le travail non rémunéré interne aux ménages peut être estimé pour ces pays à une valeur variant entre un tiers et deux tiers de celle du PIB.
[9] Dans cette optique, l’input est la quantité de facteurs qui entrent dans le processus de production. Généralement, on distingue le facteur travail, et le facteur capital.
[10] En effet, ce que l’on inclut dans le PIB/PIN au titre de l’extraction de ressources non renouvelables provient d’un prélèvement sur la nature. L’économie ne produit pas la ressource naturelle elle-même. Celle-ci résulte d’un très long processus de transformation physico-chimique.
[11] CCF : Consommation de capital fixe
[12] L’objection principale à cette idée est que les prix de marché (les valeurs économiques) sur lesquels les comptes nationaux, et donc le PIB, sont basés excluent par hypothèse (puisqu’il s’agit de dommages dont le coût n’est pas supporté par les activités économiques) toute composante correspondant à la « consommation » de cette fraction d’actifs naturels. Si les coûts de ces dommages à l’environnement devaient être effectivement pris en charge par l’économie (être « internalisés »), alors le systèmes des prix et des quantités serait modifié et on obtiendrait, entre autres, un autre PIB qui ne pourrait être estimé que par une modélisation complexe.
[13] Par exemple, une usine de pâte à papier prélève dans une rivière l’eau dont elle a besoin dans son processus de production. Elle rejette ensuite l’eau usée dans la rivière qu’elle pollue, rendant celle-ci impropre à divers usages. L’eau de la rivière, élément du patrimoine naturel, voit sa qualité se dégrader. Les utilisateurs de la pâte à papier, et aux delà ceux des articles en papier, paient seulement les coûts de production qui sont inclus dans le prix de la pâte à papier (bois, chiffons, électricité, main d’œuvre). En l’absence de régulation imposée, le prix de la pâte à papier n’inclut pas le coût que l’usine devrait supporter, soit pour modifier son processus de fabrication afin d’éviter ou limiter ces rejets, soit pour dépolluer l’eau de la rivière. Les coûts pour la nature, les coûts écologiques, sont dans cette hypothèse des coûts non payés. Si on introduit une obligation pour l’usine, soit de ne pas polluer, soit de supporter le coût de la dépollution, alors les coûts non payés deviennent des coûts payés. On dit alors que les coûts écologiques ont été internalisés, c’est-à-dire que l’économie paie pour éviter ou compenser les dommages aux actifs naturels considérés.
[14] La méthode de l’évaluation contingente en est un bon exemple : l’idée est d’identifier le consentement à payer des individus pour différents biens, ou différentes unités de biens. Les questions commencent souvent par : « combien êtes-vous prêt à payer pour… ». Ces questions peuvent être étendues à des enjeux et objets environnementaux.
More Articles...
- Evaluation : (Epreuve composée) : Le PIB est-il un indicateur pertinent pour mesurer les richesses créées ?
- Synthèse - Qui crée des richesses et comment les mesurer ?
- TD 2 - Apprendre à rédiger une synthèse de cours
- TD 1 - Maîtriser les chiffres de la croissance
- Activité 3 - Quelles sont les limites du PIB comme instrument de mesure de la production ?
- Activité 2 - Comment mesurer la production d'un pays ?
- Activité 1 - Comment mesurer les résultats d'une entreprise ?
- Exercices de synthèse : qui crée des richesses ?
- TD n°2 - Diversité des entreprises selon le nombre de salariés
- Approfondissement - jeu de rôle : la campagne de vaccination lors de la grippe h1n1
- TD n°1 - Maîtriser des concepts : quelles attentes ?
- Activité 3 - Quelles relations entre les agents économiques dans le domaine de la santé ?
- Activité 2 - Qui d'autre produit dans le domaine de la santé ?
- Activité 1 - Production marchande et non marchande : le cas de la grippe H1N1
- Qui crée des richesses et comment les mesurer ?
Tous les TD (utilisables aussi en AP)
 Tous les TD de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Tous les TD de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Les évaluations
 Toutes les évaluations de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Toutes les évaluations de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...