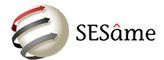Le programme
Les séquences de cours
Identification
S'abonner à la Newsletter
Entretien avec Bernard Guerrien et Roger Guesnerie
- Details
- Parent Category: Marchés et sociétés
- Category: Les marchés sont-ils efficaces ?
- Last Updated on Monday, 05 March 2012 20:32
- Published on Wednesday, 01 February 2012 20:10
Bernard Guerrien est économiste. Il est chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne, université Paris 1. Publications l Page personelle l Page professionnelle
Roger Guesnerie est économiste. Il est professeur au Collège de France, Directeur d'études à l'EHESS et Directeur de recherche au CNRS. Publications l Page professionnelle
1) Dans quels domaines les modèles économiques sont-ils le plus utiles ?
Bernard Guerrien On distingue deux grands types de modèles économiques : ceux qui relèvent de la microéconomie et ceux qui relèvent de la macroéconomie. L’approche microéconomique consiste à partir des choix de ménages ou d’entreprises imaginaires qui cherchent à maximiser leur satisfaction ou leur profit, compte tenu du caractère limité des ressources disponibles. Les modèles qui adoptent cette approche ne sont d’aucune utilité : il suffit de jeter un coup d’œil aux manuels de microéconomie pour constater qu’ils racontent de petites histoires – où les ménages et les entreprises sont réduits à une fonction, au sens mathématique – dans des mondes inventés de toutes pièces, mais qui facilitent le traitement mathématique. Les quelques données qu’on peut y trouver – en particulier, celles qui servent à construire des courbes d’offre et de demande – sont purement imaginaires. Elles sont fabriquées par les auteurs des manuels, pour illustrer leur propos.
La situation est très différente dans les ouvrages de macroéconomie où on trouve, au contraire, des données extraites, par exemple, des publications de l’INSEE. Données qui portent sur le PIB, la consommation, l’investissement, l’emploi, la masse monétaire, le niveau des prix, etc. et cela par pays ou par zones géographiques, pour des périodes déterminées, plus ou moins longues. Les modèles de la macroéconomie sont constitués d’identités comptables, qui résultent de la définition même des agrégats mesurés (le PIB se décompose, par exemple, en consommation et épargne), et de relations qui décrivent une sorte de comportement moyen des agents économiques, tel qu’il peut être suggéré par l’examen des données disponibles ou par introspection. Contrairement à ceux de la microéconomie, ces modèles sont utiles puisqu’ils constituent des sortes de maquettes qui représentent, de façon plus ou moins simplifiée, l’économie d’un pays, d’une région, etc. Ils sont utilisés aussi bien par les entreprises que par l’Etat pour faire des prévisions, en envisageant divers scénarios possibles concernant le futur. Autrement dit, ce sont des outils de décision, parmi bien d’autres. Il est vrai que les prévisions des modèles macroéconomiques laissent souvent à désirer. Mais mieux vaut avoir une base de travail et de réflexion que d’opérer totalement à l’aveugle – ou purement au pif. Quitte à tirer les leçons de ses erreurs et à chercher à faire mieux la fois d’après. Sans trop d’illusions, quand même …
Roger Guesnerie Les modèles essaient de décrire, en langage mathématique, une situation économique. L’objectif est d’améliorer la compréhension du phénomène à l’étude. Par exemple, c’est pour préciser et mieux appréhender l’idée que le volume de la demande qui s’adresse à un bien diminue lorsque son prix s’accroît, qu’Augustin Cournot introduit en 1838 la « fonction de demande » : il fait de la quantité demandée une fonction, au sens mathématique du terme, du prix. La fonction de demande est donc un outil qui permet de décrire de façon plus synthétique la façon dont la quantité décroît avec le prix, mais aussi de façon plus efficace qu’on ne le ferait avec des mots : la « fonction » incorpore toute l’information, par exemple, aux travers des élasticités qui s’en déduisent.
La modélisation était donc pour lui une forme de secours au raisonnement intuitif qu’il avait en tête. La remarque vaut en général. Pour parodier une formule célèbre, » la modélisation n’est que le prolongement du raisonnement par d’autres moyens ». La modélisation est donc d’autant plus nécessaire que la complexité des situations les fait échapper à notre compréhension immédiate. Là où elle est le plus utile est là où notre compréhension vient le plus buter. On peut en prendre l’exemple d’une des grandes polémiques autour desquelles s’est construite la discipline économique au 19èmesiècle, celle concernant la stabilité systémique : le système capitaliste de marché est-il stable, comme le pensait Jean Baptiste Say, ou instable, comme le pensaient Jean-Charles Sismondi et Karl Marx ? Entre les deux Léon Walras, qui n’est convaincu ni par les arguments des uns ni par ceux des autres, et qui pour se faire une opinion se lance dans la construction d’un « modèle d’équilibre général », qui s’essaie à prendre la question dans toute sa complexité (beaucoup de biens beaucoup d’agents, ce qui requiert beaucoup de mathématiques…. [1]
Evidemment, la complexité du monde et des questions n’a pas diminué au 20ième siècle et plus encore en ce début de 21ième siècle
2) Les modèles économiques parviennent-ils à expliquer la formation des prix ?
Bernard Guerrien La formation des prix résulte d’un processus très complexe, dans lequel interviennent à la fois les conditions de production des biens, leur destination – consommation ou investissement, par exemple – et la forme d’organisation des relations entre les agents économiques. Il serait vain pour les entreprises, qui fixent généralement le prix des biens, de chercher à modéliser ce processus. On observe, en fait, que la grande majorité d’entre elles adopte la règle relativement simple qui consiste à prendre comme référence leur coût de production, auquel elles rajoutent une marge, qui tient compte de l’environnement dans lequel elles opèrent : présence d’autres entreprises proposant le même produit, ou des produits plus ou moins proches, réglementation en vigueur, régime de taxation, incertitude (« climat des affaires »). On peut, sachant cela, chercher à évaluer le taux de marge dans les divers secteurs – ou même à un niveau plus fin – puis proposer un modèle simple de formation des prix qui colle relativement bien aux données et aux comportements observés.
Cette solution n’est cependant pas très satisfaisante. Elle n’explique pas comment se forme le taux de marge et, surtout, elle a l’inconvénient de « tourner en rond » : les prix dépendent des coûts, qui eux-mêmes dépendent des prix. Pour briser ce cercle vicieux, les économistes dits « classiques », comme Adam Smith et David Ricardo, mais aussi Karl Marx, proposent de prendre le temps de travail nécessaire à la production d’un bien comme l’élément déterminant de son prix. C’est la théorie de la valeur travail. Sa modélisation se heurte toutefois au problème de l’évaluation du « travail passé » incorporé dans les machines et les matières premières qui interviennent dans la production des biens. Les économistes dits « néo-classiques » avancent une autre explication, où les goûts des consommateurs et les techniques de production sont mis en avant. Le modèle qu’ils proposent suppose toutefois une forme d’organisation de l’économie très centralisée – où des « courbes d’offre » sont « confrontées » à des « courbe de demande » –, qui n’a rien à voir avec la formation des prix telle qu’on l’observe dans la réalité. Ce modèle ne peut donc être pris au sérieux.
Souvent, les sociologues et les anthropologues – plus proches du terrain que les économistes – nous apprennent plus sur la formation des prix que les économistes. Sans qu’ils cherchent à proposer un modèle universel en ce qui la concerne.
Roger Guesnerie Les prix sur un marché résultent de la confrontation de l’offre et de la demande : c’est une idée qui relève en partie du sens commun et que les débats du 19ème siècle, et les réflexions qu’ils suscitent, comme celle de Cournot, ont précisée. Plus de demande, au sens d’une courbe de demande plus élevée, augmentera le prix d’équilibre sur un marché, plus d’offre tendra à le faire diminuer. C’est ce que j’appellerai le modèle stylisé de formation des prix, qui fournit, si l’on veut , une première « grammaire » de l’argument. En quoi est-elle trop simpliste ? Quelles sont les limites à ce raisonnement ?
J’ai déjà évoqué la première limite en répondant à la question précédente. Le point de vue d’un marché isolé, celui qui est associé au nom d’ Alfred Marshall, grand économiste anglais du début du 20iéme siècle, est insuffisant. L’on ne peut tout à fait comprendre ce qui se passe sur un marché sans comprendre les marchés proches où s’échangent des marchandises de caractéristiques voisines, voire sans comprendre ce qui se passe sur tous les marchés – c’est nécessaire si l’on veut comprendre les fluctuations globales de l’économie. On passe du point de vue de Marshall à celui opposé d’un de ses élèves, John Maynard Keynes, ou encore à celui de Léon Walras.
Revenons au registre du marché isolé, registre de réflexion à la fois insuffisant et indispensable pour une compréhension globale. La grammaire offre-demande que je viens d’évoquer est, c’est la deuxième limite que je voudrais souligner, trop simpliste : les spécificités de chaque type de marché sont gommées. Non seulement les formes de concurrence, et donc l’offre, comme l’avait souligné Cournot, peuvent en être affectées, mais l’analyse des spécificités doit aller au-delà et être exhaustive. Dans les faits il y a une multitude de marchés. Le ou les « marché(s) du travail » ont une logique de fonctionnement très différente des marchés de biens. Parmi ceux-ci, le marché des fruits et légumes ressemble peu à celui de l’automobile. Un marché de matières premières, comme celui du pétrole, est très différent d’un marché de bien industriel ; un marché de titres financiers est différent d’un « marché du logement ». Ce qui ne veut pas dire que la grammaire de l’argument stylisé offre-demande est inopérante. Par exemple, si l’on prend le marché du travail, qui rentre mal dans le cadre simplifié, l’histoire économique suggère que les effets offre demande jouent mais de façon différée et éventuellement atténués ou exacerbés par des dispositions légales. Compliquer l’analyse conduit à amender le modèle de base trop simple, sans pour autant nécessairement le discréditer.
3) Par définition un modèle est irréaliste ; mais un modèle manifestement très irréaliste (par exemple où la monnaie est absente) peut-il avoir une valeur scientifique ?
Bernard Guerrien Mieux vaut parler de pertinence que de réalisme. Il peut ainsi être pertinent de réfléchir aux conditions de la production ou de la consommation en abstrayant l’existence de la monnaie. De même en ce qui concerne l’échange : il n’est pas absurde de calculer le nombre d’heures, ou de mois, que je dois travailler pour pouvoir me payer une voiture ou une maison. Une mesure de ce genre est d’ailleurs utilisée pour les comparaisons dans le temps (évolution de la productivité du travail, par exemple) ou dans l’espace (entre pays). En revanche, le modèle dit « de concurrence parfaite » n’est pas pertinent parce qu’il suppose un monde dans lequel il est interdit aux ménages et aux entreprises de proposer des prix et de faire des échanges directs entre eux. Ce monde est organisé par une sorte de chef d’orchestre – ou par un ordinateur dont les tâches sont programmées à l’avance[2] – qui cherche les prix d’ « équilibre » et organise les échanges quand il les a trouvés. Ce modèle n’est pas scientifique, car il n’existe nulle part dans le monde une économie organisée, de près ou de loin, de la sorte[3].
Un modèle est un ensemble d’hypothèses ; il est forcément simplificateur puisqu’il ne prend en compte que quelques aspects de la réalité. Une démarche qui se veut scientifique doit présenter clairement les hypothèses du modèle, de sorte qu’il soit possible de juger de leur pertinence, de leur relation avec la réalité qu’elles sont censées décrire. En économie, il est très courant – hélas ! – que les hypothèses des modèles soient noyées dans un discours fumeux (par exemple, les « quatre conditions » de la « concurrence (pure et) parfaite ») ou bien dans des formulations mathématiques accessibles aux seuls initiés. Avant d’aborder l’étude d’un modèle en économie, ou d’en accepter les conclusions, il faut donc exiger que la signification exacte, d’un point de vue économique, de ses hypothèses soit précisée. Très peu de modèles mathématiques en économie survivent à cette épreuve, tellement leurs hypothèses vont à l’encontre de ce que l’on observe.
Roger Guesnerie Il faut revenir à la première partie. Les modèles sont irréalistes, mais il en va de même des raisonnements littéraires que l’on fait sur le monde. Si un modèle est un « prolongement du raisonnement par d’autres moyens », il s’essaie en principe d’être moins irréaliste que les raisonnements auxquels il se substitue ou plutôt qu’il prolonge. Ce qui ne veut pas dire qu’il y réussit toujours. Le modèle est en effet soumis à un test de cohérence (le lien entre les hypothèses que l’on fait et les conclusions que l’on tire) que l’argumentation littéraire évite en partie. A nouveau la cohérence peut brider l’argument à l’excès… mais j’hésiterai à faire l’éloge de l’incohérence pour la production d’un savoir qu’on l’appelle scientifique ou d’intention scientifique.
Un mot sur la monnaie. Lorsque l’on parle de fiscalité ou de production de bien non marchand par le secteur public, il n’est pas très utile d’introduire de la monnaie dans le raisonnement qu’il soit littéraire ou modélisé. Comme un raisonnement littéraire, un modèle raconte une histoire simplifiée. Et nous ne comprenons le monde qu’en le simplifiant, même si la question du bon niveau de simplification se pose tant dans le raisonnement formalisé[4] que dans le raisonnement libre. Certains voient dans les modèles non tant des substituts du raisonnement que des substituts du laboratoire, au sens où ils permettent de tester des idées ou de simuler des politiques. Ils joueraient dans le monde social le rôle que joue l’expérience contrôlée dans le monde physique.
Quoi qu’il en soit, je ne veux pas dire que la modélisation, et ce qui historiquement l’a accompagné, l’usage de techniques statistiques sophistiquées, doive échapper à la critique. Je n’ai pas la place pour aller bien loin dans cette direction. J’évoque seulement une critique parmi d’autres, la modélisation accompagne la balkanisation[5] du savoir économique, qui est un problème majeur de notre époque.
Un dernier mot sur la monnaie. Sujet passionnant qui revient sur la scène avec la crise. Le paysage a changé ces dernières années, le sujet semblait complétement sous contrôle, la gestion des banques centrales était devenu un problème technique que l’on comprenait parfaitement, leur mission était si clairement définie qu’elle justifiait la mise hors de la tutelle étatique et Patatras…. La monnaie revient sur le devant de la scène et avec elle l’histoire et la théorie monétaire sont sur la sellette. Nos modèles, mais tout autant nos raisonnements littéraires se sont égarés. Echec de la modélisation ? En un certain sens oui, mais est-ce parce qu’il y a eu trop ou trop peu de modélisation ? Echec de la pensée en tous cas… Et du pain sur la planche…
[1] Une autre grande polémique concerne les relations entre les valeurs travail des biens et leurs prix sur les marchés. Question qui vient au moins de Ricardo, et qui passionnait les classiques. Mais ici la logique des choses oblige à prêter attention aux « choses de la logique ». Et la relation valeurs prix, que l’on peut encore comprendre dans un monde où il n’y aurait que deux biens, devient impénétrable dès qu’il y en a beaucoup plus, ce qui est le cas dans la réalité. Sans doute est- ce pour cela que Marx, que la question passionnait, s’était mis à l’étude de l’algèbre à la fin de sa vie...
[2] Il est usuel de parler du « marché » à son propos, ce qui est absurde. Le marché est une notion vague, mais personne ne songe sérieusement à en faire une personne ou une machine. Les économistes qui se sont un peu sérieusement penchés sur la question parlent, à propos de l’entité qui propose les prix, de « secrétaire du marché », de « commissaire-priseur », d’ « agent du marché » ou même de « joueur fictif ». Ils le présentent, faute de mieux, comme une « abstraction », sans donner d’exemple précis (puisqu’il n’en existe pas !).
[3] Certains économistes pensent que ce genre d’organisation – où un « centre » (un planificateur, par exemple) utilise les prix pour coordonner les actions individuelles – pourrait être une alternative valable au capitalisme. Elle aurait l’avantage d’éviter, ou de limiter, les désordres et les gaspillages propres aux économies de marché – du fait, entre autres, de l’absence de coordination entre les agents.
[4] par formalisé, l’auteur entend « qui utilise le langage mathématique »
More Articles...
- Entretien avec James Galbraith et Pascal Salin
- Synthèse - Les marchés sont-ils efficaces
- TD 1 – Les asymétries d’informations – L’exemple des voitures d’occasion
- Activité 3 – Quelle articulation entre Marché et Etat pour les services publics ? l’exemple du rail
- Activité 2 - Le marché peut-il produire tout type de biens ? Le cas des biens collectifs
- Activité 1 - Le marché produit-il toujours les quantités adéquates ? Le cas des externalités
- Les marchés sont-ils toujours efficaces ?
Tous les TD (utilisables aussi en AP)
 Tous les TD de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Tous les TD de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Les évaluations
 Toutes les évaluations de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...
Toutes les évaluations de SESâme en un clin d'oeil. Consultez...